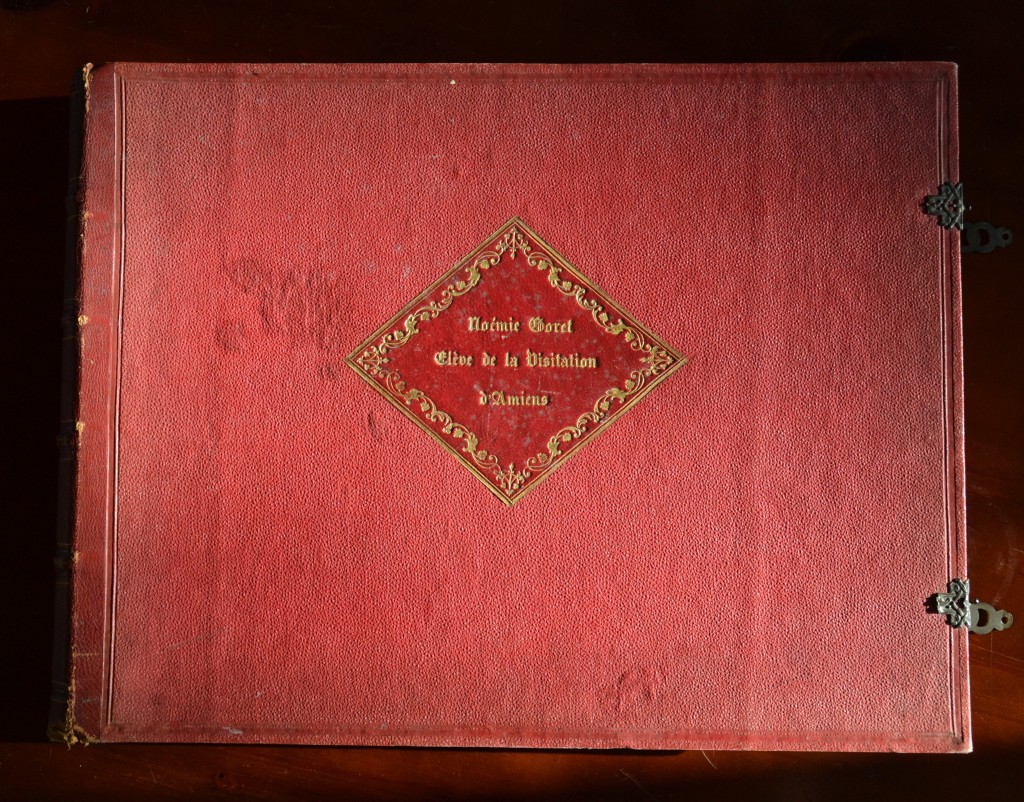J’ai du sang belge ! (première partie)
Mes archives devaient forcément me conduire à explorer la face maternelle et belge de mes origines. Avec mes cousins, lorsque nous étions enfants, nous réalisions des calculs rudimentaires pour évaluer la proportion de sang belge qui circulait dans nos veines, ce qui n’est pas si simple car les pistes sont tortueuses.
Notre grand-père Ladislas De Bruyn, au patronyme parfaitement flamand, né à Godinne-sur-Meuse[1] en Belgique, était cependant de nationalité française.
Notre arrière-grand-père belge, Hilaire Samain, dont le nom nous semblait d’origine wallonne, était flamand bien que francophone.
Notre grand-mère Marthe Samain, belge, née à Fleurus, de père flamand et de mère wallonne, a acquis la nationalité française par son mariage avec Ladislas De Bruyn …
Nous revendiquer d’une ascendance en partie étrangère, imaginer et côtoyer un univers familial en partie peuplé de cousins belges, d’un grand-oncle évêque dans le diocèse de Tournai, d’une grand-tante ayant rapporté du Congo belge un bébé crocodile empaillé, tout cela nous apparaissait terriblement exotique !
L’itinéraire choisi de trois de mes ancêtres me permet d’explorer les relations qui font de la France et de la Belgique des États si proches et cependant bien distincts.
En quoi les quelques éléments qui me sont connus de la vie de mon arrière-grand-père André De Bruyn et des siens me permettent-ils de m’interroger sur la question de l’existence et de la permanence de l’État belge ?
1. Une famille transfrontalière


Pour point de départ, une cloche ; celle qui, pendue à une potence dans la cour du « Moulin de l’étang », la maison de mes grands-parents à Cambronne-lès-Ribécourt, servait à battre le rappel à l’heure des repas. Cette cloche porte le nom du bateau dont elle était un élément : Actif II. Avec Actif I, III, IV et V et la Jeanne d’Arc, Actif II faisait partie de la flotte de remorqueurs de mon arrière-grand-père André De Bruyn.

Né en France en 1879 à Annœullin, près de Lille, il épouse en 1902 Isabelle du Ry originaire de Godinne-sur-Meuse, en Belgique. Le jeune couple s’installe quelques temps en bord de Meuse, au « château de Chauveau », domicile de la jeune mariée : on dit que sa mère, Marguerite, ne voulait pas voir sa fille s’éloigner d’elle. Marguerite, née au château de Frasnoy[2] près du Quesnoy, est française ; elle est issue de la famille Motte, la grande famille d’industriels du Nord. Elle est la veuve de Charles du Ry, juge d’instruction namurois et propriétaire immobilier « à l’aise ». La légende familiale veut que Charles soit tombé fou amoureux de Marguerite rencontrée à la faveur d’un voyage en train ; elle dit aussi que Charles pouvait encercler la taille de guêpe de sa jeune femme de ses deux mains et que, devenue vieille, il fallait deux chaises à Marguerite pour s’asseoir ! André et Isabelle font construire à proximité du château de Chauveau la « villa de la Corniche », les naissances se succédant à un rythme soutenu, ils ont bien fait de prévoir grand. Sur l’acte de naissance de mon grand-père Ladislas, le cinquième de la fratrie, né le 24 août 1908, figure l’indication de la profession de ses parents. Pour sa mère, « aucune », ce qui n’étonne guère s’agissant d’une mère de famille bourgeoise nombreuse ; pour son père, « rentier ». Quelle signification recouvre ce terme lorsqu’il est question d’un jeune homme de 28 ans ? Probablement, la possibilité qui a été la sienne d’investir son argent (héritage et dot de sa femme) dans une flotte de remorqueurs à vapeur tirant des chalands sur la Meuse. Et probablement aussi sa capacité à acheter des voitures de course de marque Panhard et Sava, à une époque où la locomotion automobile n’est encore qu’une bizarrerie réservée aux loisirs d’une petite élite[3]. Son intérêt pour les moteurs et la mécanique ont certainement motivé ce choix d’activité.


Les archives de cette société de transport ne me sont pas parvenues et je n’ai pas trouvé d’études traitant en détail de la question du trafic fluvial au tournant des XIXe et XXe siècles. Il semble que les péniches assuraient des liaisons entre le port d’Anvers (en passant par le canal Charleroi-Bruxelles et le canal maritime de Bruxelles à l’Escaut ?) et Paris (via le canal des Ardennes, l’Aisne et l’Oise et leurs canaux latéraux ?) ; pas d’indications sur la nature des marchandises transportées (probablement pour partie du charbon et du minerai de fer – la Meuse, et son affluent la Sambre, traversant les régions minières et industrielles du sud de la Belgique et du Nord et de l’Est de la France – ainsi que des marchandises débarquées dans le port d’Anvers)[4].

2. Indépendance et neutralité de la Belgique
Lorsqu’André De Bruyn s’installe en Belgique, le jeune royaume n’a pas un siècle d’existence. L’observation des principales voies d’eau permet de se poser la question du pourquoi de la création en 1830 d’un État belge indépendant. Les fleuves belges – Escaut, Meuse, Rhin – sont tout autant hollandais, français et allemand. Leur orientation Sud/Nord, avant l’inflexion Est/Ouest jusqu’à la mer du Nord, en font des axes de communication et de pénétration. C’est un territoire qui semble destiné à être traversé ou occupé par les voisins jusqu’à atteindre une frontière naturelle, ce que n’est pas la frontière franco-belge – dont le tracé a beaucoup changé – mais ce que pourrait être le Rhin[5].
Sous les règnes de Louis XIV et de Louis XV, les Pays-Bas dits espagnols puis autrichiens ont fait l’objet des convoitises françaises ; ce sont cependant les victoires de l’armée révolutionnaire qui permettent leur complet rattachement à la République Française en 1795 et leur découpage en départements. Est alors inaugurée une période d’unité tant sur le plan politique que sur le plan économique. Au cours de la séquence Consulat – Premier Empire, les efforts sont portés sur le développement du réseau de voies navigables permettant la constitution d’un vaste marché franco-belge[6]. Le charbon, principale ressource du territoire belge, ne connaît plus d’obstacles quant à sa circulation (suppression des taxes douanières et des péages élevés sur les voies navigables) ce qui entraine l’accélération de sa production et son introduction en masse sur le territoire français. La concurrence infligée aux charbonnages français, moins compétitifs, a pour conséquence la constitution de stocks d’invendus et la mise au chômage partiel des mineurs français[7]. Cette situation se prolonge après 1815, lorsqu’au Congrès de Vienne la décision est prise du rattachement des anciens Pays-Bas autrichiens aux Provinces-Unies pour former le royaume de Hollande.
Voulue par l’Angleterre, la création de ce nouveau royaume a pour but de mettre fin aux prétentions françaises sur les territoires belges, la France étant alors ramenée à ses frontières de 1790.
Dans le contexte de la montée des nationalismes, ce rattachement est rapidement remis en cause. Englobés dans le royaume de Hollande, les anciens Pays-Bas autrichiens ne se sentent pas reconnus dans leurs spécificités : catholicisme, usage de la langue française par les élites, y compris flamandes. Une jeune bourgeoisie libérale se forme dans les universités de Liège, Gand et Louvain (trois universités d’État fondées en 1817 par Guillaume Ier de Hollande) ; évincés de l’administration réservée aux Hollandais, ces jeunes Belges, éduqués et libéraux, deviennent, pour certains, avocats et journalistes et ces publicistes effectuent un rapprochement de circonstance avec les catholiques pour réclamer l’indépendance.
C’est pourquoi, même si les Belges sentent toujours planer la menace d’une volonté annexionniste française (à laquelle certains seraient d’ailleurs favorables), la Révolution belge de 1830 a partie liée avec les « Trois Glorieuses » et la montée sur le trône de France de Louis-Philippe ; c’est la même idéologie libérale qui s’exprime.

Pour le nouvel État belge indépendant, c’est un régime monarchique qui est porté sur les fonts baptismaux par l’Angleterre et la France, il ne pourrait en être autrement au sein de l’Europe issue du Congrès de Vienne d’où la République est bannie. Pour lui donner corps, c’est Léopold de Saxe-Cobourg, prince allemand et luthérien, qui a été choisi comme premier roi des Belges. Veuf de la fille du roi George IV d’Angleterre (il est aussi l’oncle maternel de la future reine Victoria dont il est très proche), il vit à Londres et c’est le pion de l’Angleterre. Pour faire bonne mesure, on lui donne pour femme Louise d’Orléans, la fille de Louis-Philippe, ce qui permet de calmer les velléités annexionnistes françaises. Effectivement, la France se serait bien saisie de l’occasion de la Révolution belge pour étendre son territoire vers le nord, mais l’Angleterre veille à l’en empêcher. Léopold le dit lui-même dans une lettre à Metternich[8] : « Je suis venu certainement là pour empêcher que la Belgique en partie ou tout entière ne puisse tomber entre les mains de la France. »[9]
La Russie, la Prusse et l’Autriche soutiennent la Hollande qui ne veut pas renoncer aux territoires belges. Si l’Angleterre qui fut à l’origine de la création d’un grand royaume de Hollande décide d’y renoncer pour soutenir la naissance d’une Belgique indépendante, c’est pour voir diminuer la puissance de sa rivale dans les domaines maritime et commercial, et cela vaut bien un rapprochement avec la France.
Pour entériner l’existence de la Belgique, il faut de nombreuses négociations et toute une série de traités (la Hollande et la Belgique exprimant alternativement leurs désaccords) dont le dernier, datant de 1839, fixe les frontières, décide du partage de la dette entre les deux pays, contient des clauses concernant l’usage des fleuves et des ports. Les Hollandais conservant le contrôle des deux rives des bouches de l’Escaut, la question de la circulation sur ce fleuve représente une pierre d’achoppement ; les grandes puissances imposent l’internationalisation de l’accès au port d’Anvers mais les Hollandais obtiennent le paiement d’un péage dû par les navires empruntant l’Escaut[10]. L’Angleterre aide au développement des ports d’Anvers et d’Ostende qui servent au débarquement des marchandises britanniques sur le continent.
Le principe de la neutralité de la Belgique est acquis, tant pour la protéger des prétentions de ses voisins que de ses propres tentations à se laisser prendre par eux.
Il faut du temps pour que se consolide le royaume de Belgique comme il faut du temps à Léopold pour se voir en garant de l’existence de la Belgique. Il s’interroge à propos de la réelle volonté des Belges de rester indépendants et lui-même exprime des doutes quant à sa volonté d’être belge ; dans une lettre adressée en 1841 à sa nièce la reine Victoria, il exprime son regret de n’avoir pas accepté la couronne de Grèce qui lui fut proposée avant celle de Belgique : « (…) Je voudrais bien faire un chassé-croisé avec Othon[11] ; il gagnerait au point de vue des écus et moi j’aurais le soleil et un pays intéressant »[12].
Paradoxe d’une époque qui donne naissance à de nouveaux États à partir de greffons tirés des vieilles dynasties européennes, en même temps qu’elle est celle des nationalismes : il revient à un étranger de devenir belge et de créer un sentiment national belge.
La Belgique doit se garder de brader son indépendance. En 1842, on discute de la mise en place d’une union douanière franco-belge. Le marquis de Rumigny, diplomate français en poste à Bruxelles de 1840 à 1848, veut croire que « cette idée ne répugne pas à la population, ses meilleurs souvenirs sont encore ceux de l’époque de sa réunion avec la France jusqu’en 1814. Sous une foule de rapports, ils ont laissé de vifs regrets, commercialement surtout. »[13] Sur injonction de l’Angleterre qui redoute qu’un rapprochement avec la France nuise à ses intérêts économiques, elle est contrainte de refuser ce projet. En effet, la création d’un marché franco-belge entrainerait la croissance de la production belge et aurait pour effet de priver l’Angleterre de débouchés pour son industrie.
Au même moment, la Prusse cherche à intégrer la Belgique au Zollverein (l’union douanière allemande) et ce serait là un casus belli pour la France.
En 1848, la Belgique ne se laisse pas toucher par le « Printemps des Peuples » qui se propage en Europe. La fièvre révolutionnaire qui s’empare à nouveau de la France ne l’atteint pas et elle repousse les révolutionnaires républicains français. Elle possède déjà une constitution libérale (Karl Marx, réfugié en Belgique de 1845 à 1848, se réjouit d’y profiter de la liberté d’expression et du droit d’association[14]) garantie par un roi non belge et non catholique : les événements de 1848 mettent en évidence qu’autour de la monarchie, se sont pourtant renforcés le sentiment national et la volonté de préserver l’indépendance du territoire.
En France, la République sociale issue de la Révolution de février 1848 tourne rapidement court et l’élection de Louis-Napoléon Bonaparte, le prince-président, signe la fin prochaine de la République. Devenu empereur des Français le 2 décembre 1852, Napoléon III se pique d’avoir une politique étrangère active, se faisant particulièrement le champion de Victor-Emmanuel II de Piémont-Sardaigne dans son entreprise d’unification italienne. Comme prévu par des accords secrets (négociés entre Napoléon III et Cavour[15] dans la petite station thermale de Plombières-les-Bains dans les Vosges, très prisée par l’empereur), la signature du traité de Turin en 1860 entérine le rattachement à la France du comté de Nice et de la Savoie. Cet événement sans rapport apparent avec la Belgique y provoque cependant de vives inquiétudes. La presse bonapartiste, applaudissant les entreprises napoléoniennes, exprime le souhait que l’on n’en reste pas là : la Belgique ne possède rien de ce qui fait une nation, et mieux, cette presse affirme que le désir le plus profond des Belges est de voir leur territoire rattaché à la France. En Belgique, où une prudente réserve et l’application du principe de neutralité avaient impliqué une absence de réaction à l’extension de la France dans les Alpes, le retour de la menace annexionniste française provoque un élan patriotique. Cela se manifeste particulièrement par l’expression de l’attachement à la personne du roi le 21 juillet, date anniversaire de la prestation de serment de Léopold Ier et qui devient la fête nationale officieuse. Sous l’effet de la panique, le parlement vote des crédits pour le renforcement des équipements militaires à proximité de la frontière franco-belge, ce qui restera largement lettre morte, le gros des efforts en matière de défense restant consacré au développement du « réduit anversois » qui doit servir de refuge en cas d’invasion de la Belgique[16].
Le démenti officiel français dissimule mal les intentions de Napoléon III qui réclamera la Belgique à Bismarck en 1865. On sait ce qu’il en advint : 1871, la défaite française, la chute de Napoléon III, la création du IIe Reich et l’annexion de l’Alsace-Moselle par l’Allemagne …
3. Une carrière d’armateur contrariée
Au début du XXe siècle, la Belgique connaît une période de prospérité qui repose sur l’exploitation des ressources de son sous-sol, sur sa production industrielle, sur son réseau de voies de communication et sur sa main d’œuvre abondante et bon marché. Le port d’Anvers est dynamique, assurant notamment les liaisons entre l’Europe et l’Amérique du sud. À la fin du XIXe siècle, une partie du réseau de voies navigables a été adaptée au gabarit Freycinet[17], mais il demeure incomplet : il manque une liaison Meuse-Escaut qui ne sera réalisée qu’en 1939 avec le creusement du Canal Albert.
La situation des Bouches de l’Escaut, maintenues en territoire hollandais en dépit des revendications belges, motive la création d’une voie ouest-est pour relier Anvers à la région rhénane, liaison nécessaire pour assurer la pérennité du grand port belge. Les Hollandais n’ont aucun intérêt à favoriser la circulation sur l’Escaut en direction du port d’Anvers qui concurrence celui de Rotterdam. La création d’une voie de chemin de fer semble une bonne solution et une garantie d’indépendance. Le « Rhin de fer » qui relie Anvers à Cologne est inauguré en 1843 sur fond de rapprochement commercial avec le Zollverein[18] . L’implication de l’État montre que le chantier représente un enjeu patriotique et national. Il se charge du développement de l’armature principale à vocation internationale, à partir de laquelle des sociétés privées, qui obtiennent des concessions temporaires, tissent un réseau secondaire pour répondre aux demandes des villes et régions : « c’est la composante nationale et politique du réseau »[19]. L’aménagement du réseau de chemin de fer apparaît donc comme un moyen de façonner le territoire national belge.
Dans un article qu’il signe en 1845 dans la Revue des deux Mondes, Charles Coquelin[20] décrit la naissance des premiers réseaux de chemin de fer européens et en compare les atouts et faiblesses avec ceux des réseaux de voies navigables ; il s’inquiète d’une possible concurrence néfaste au transport fluvial, l’État belge proposant des tarifs peu élevés pour le rail là où les voies ferrées sont parallèles avec une voie navigable. Dans un contexte de développement capitaliste, l’auteur craint une baisse de rentabilité pour les compagnies propriétaires des canaux qui vont devoir baisser les tarifs de leurs péages alors qu’elles sont soumises à d’onéreux travaux d’entretien.
On peut d’abord parler de complémentarité : des propriétaires et investisseurs belges et français s’unissent pour développer le réseau ferré et compléter celui des voies navigables[21]. C’est le cas de la « maison parisienne Rothschild » qui possède des intérêts dans l’approvisionnement de Paris en charbon. Cependant, au tournant des XIXe et XXe siècles, malgré le gain de vitesse provoqué par l’usage de remorqueurs à vapeur en remplacement du halage humain ou animal, la navigation fluviale amorce son déclin et c’est dans ce contexte qu’André De Bruyn a lancé son activité.

Quoiqu’il en soit, la carrière d’armateur d’André en Belgique a été de courte durée, 12 ans au plus, de son arrivée à Godinne en 1902 jusqu’à 1914 : au début de la guerre, les remorqueurs sont confisqués par les Allemands puis coulés par les Alliés.
4. Août 1914


Deux photos nous montrent les jeunes garçons De Bruyn, protégés du soleil de l’été par leurs chapeaux, aux côtés de soldats français, pour certains vêtus de leurs lourdes capotes. Un jeune officier a le sourire aux lèvres. Ces photos ont été prises non loin de Godinne-sur-Meuse, à Annevoie, aux abords du château de Rouillon, propriété de la famille de Sauvage, amie de la famille De Bruyn.
Des extraits d’un journal dont je ne connais pas l’auteur (mais qui cite Pierre du Ry, bourgmestre de Godinne de 1908 à 1920 et beau-frère d’André), fournissent des éléments précis sur les positions des troupes françaises, et permettent de dater ces photos du 16 août 1914, au lendemain du début de la bataille de Dinant, ce que confirme le journal du Général Philippe Pétain[22], à la tête des troupes françaises dans ce secteur.
Deux semaines plus tôt, le 2 août 1914, l’invasion par l’armée allemande de la Belgique a été vécue comme un drame national, mais l’insouciance qui transparaît sur les photos ne permet de saisir ni la dureté des combats ni la retraite prochaine ; en effet, pas plus que les troupes belges, les troupes françaises ne parviendront à empêcher les troupes allemandes de franchir la Meuse.
Comme le montrent ces photos, les troupes françaises sont bien accueillies par la population locale, de même que par le gouvernement belge, malgré un vieux fond de crainte qui subsiste quant à la possibilité d’une annexion française. L’ennemi est clairement défini, c’est l’Allemand, c’est lui qui a violé la neutralité belge le premier, bien que l’intérêt de la France eût été de le devancer.
Dès 1871, les États-Majors français et allemand font des plans préparatoires à une possible guerre à venir. Le dernier plan allemand élaboré en 1914, inspiré du plan Schlieffen, prévoit non seulement le passage par la Belgique mais aussi l’occupation de son territoire.
Le général Joffre, nommé à la tête de l’État-Major français en 1911, fait cette proposition au gouvernement français : « Le plan de guerre le plus fécond en résultats décisifs dans l’éventualité d’une guerre avec l’Allemagne consiste à prendre, dès le début des opérations, une vigoureuse offensive … Il [y] aurait un intérêt majeur à ce que nos armées puissent dans tous les cas pénétrer sur le territoire de la Belgique. »[23] . La proposition est refusée, tant pour des raisons d’ordre diplomatique visant à ménager le Royaume-Uni et la Belgique elle-même que pour des questions nationales : pour l’opinion publique, c’est une évidence que le gros des troupes françaises doit être déployé à l’est, en vue de la reconquête de l’Alsace et de la Lorraine.
Les journées d’août 1914 ont été parmi les plus meurtrières de la première guerre mondiale. Si l’on en croit le Général de Langle de Cary, l’échec est dû à la mise en œuvre du plan d’opération de Joffre, contraint de se ranger à la volonté politique : « Notre attaque de Lorraine s’est heurtée à des organisations défensives puissantes (…). Nous pouvions l’arrêter [l’ennemi allemand] en restant là sur une défensive active et vigilante pendant que nous attaquions en Belgique. »[24]
Rapidement, les troupes sont épuisées par les marches forcées ; le soldat Georges Cavrois relate ainsi celle de la nuit du 14 au 15 août de Florennes à Bioul, 43 kilomètres parcourus en douze heures haltes comprises, avec pour chaque soldat un barda d’environ 20 kilos : « Cette étape anormale au cours de laquelle nous portons chacun une lourde croix, notre sac, est pour nous la première étreinte avec la réalité. La plupart de mes camarades se sont affalés dans un champ en arrivant ; ils se relèveront perclus, courbaturés à ne pouvoir remuer, percés par l’humidité de la rosée »[25]. Dans son journal, Pétain relate le même épisode : « Le temps est frais mais la marche est rendue fatigante par l’absence de sommeil. Je suis obligé de faire la route à pied afin de ne pas me laisser gagner par le sommeil à cheval. À partir de la troisième heure, des paquets d’hommes ne se lèvent plus après les haltes et il faut cogner à coup de trique pour les faire se lever. Moi-même, je suis obligé de passer le bras gauche dans une étrivière pour me soutenir »[26].
La lecture de différents témoignages permet de comprendre que l’hécatombe (84 500 morts en août 1914[27]), est pour partie liée à une certaine désorganisation : manque de cartes, défaut du renseignement militaire qui empêche l’évaluation du nombre et des positions des régiments ennemis, mauvaise communication qui conduit à l’énoncé d’ordres et de contrordres. Le 23 août, l’ordre de la retraite est donné. Tandis que les troupes françaises se replient vers le sud et repassent la frontière, les troupes belges marchent vers l’Ouest et Anvers.
Je ne dispose pas d’informations quant à la manière dont la famille De Bruyn a vécu le temps de l’occupation allemande. À moins de 20 kilomètres de Godinne, à l’abbaye bénédictine de Maredret[28], les sœurs sont bien informées des événements en cours. Elles se sont procuré un exemplaire de Patriotisme et endurance[29], la lettre pastorale du Cardinal Mercier, archevêque de Malines et primat de Belgique. Depuis Rome où il est retenu par l’élection du nouveau Pape Benoît XV de la fin août au début de septembre 1914, le Cardinal a reçu les échos des événements de la guerre. À son retour en Belgique, il constate de lui-même les énormes dégâts provoqués par les attaques allemandes qu’il relate de manière particulièrement concrète dans sa lettre[30]. Il établit une longue liste de localités martyres. S’il s’étend sur les dégâts matériels (en particulier sur les destructions qui ont touché le patrimoine architectural et culturel de Louvain et de son Université catholique, centre important de la vie intellectuelle belge), il déplore ne pas pouvoir établir le compte total des victimes civiles ; il décrit cependant de manière précise les massacres dont il a connaissance : « Des centaines d’innocents furent fusillés ; je ne possède pas au complet ce sinistre nécrologue, mais je sais qu’il y en eut, notamment, 91 à Aershot, et que, sous la menace de la mort, leurs concitoyens furent contraints de creuser les fosses de sépulture. Dans l’agglomération de Louvain, et des communes limitrophes, 176 personnes, hommes et femmes, vieillards et nourrissons encore à la mamelle, riches et pauvres, valides et malades, furent fusillés ou brûlés[31]. » Il déplore aussi les conséquences des combats qui privent des milliers d’individus de leur travail, les réduisant à la misère.
La lettre, qui appelle la population à la résistance passive, a paru pour la fête de Noël 1914 et doit être lue dans toutes les paroisses de l’archidiocèse de Malines. Elle se répand bien au-delà, au grand mécontentement de l’occupant allemand incapable d’en empêcher la diffusion malgré les pressions exercées sur le Cardinal et le clergé.
À l’abbaye de Maredret, fondée en 1893, les sœurs ont créé un atelier d’enluminure né du désir de retrouver les techniques des moines du Moyen-âge. Cette activité constitue une de leurs sources de revenus. Elles s’emparent de la lettre du Cardinal Mercier qu’elles copient et illustrent sur parchemin en s’inspirant essentiellement du Psautier de Saint-Louis[32] dont elles possèdent un fac-similé en noir et blanc[33]. Toutes les scènes sont représentées dans des décors et des costumes médiévaux, avec des anachronismes – drapeaux belges et américains, brassards à croix rouge des infirmiers, canons portant les mentions « Krupp » et « Bertha » – qui, aujourd’hui, font sourire. Cependant, la représentation tragique des souffrances endurées par le peuple belge et de l’héroïsme de ses soldats, face à des Allemands qui apparaissent fourbes et cruels, permet de penser que ce n’était pas le cas à l’époque. Le travail, véritable acte de résistance, est réalisé à l’insu de l’occupant allemand. Le manuscrit est achevé pour la visite du Cardinal Mercier à Maredret le 15 août 1916, quelques temps après la visite du Kaiser Guillaume II lui-même[34].
La manière dont les Bénédictines de Maredret ont illustré la lettre met en avant des membres de la noblesse belge dont certaines d’entre elles sont issues. Elles ont représenté le roi Albert à la tête de l’armée belge et la reine Élisabeth (princesse en Bavière) dans son rôle d’infirmière, leur intention étant peut-être de montrer l’engagement du couple royal comme preuve de ce que la dynastie d’origine germanique devient véritablement belge.
Georges Sorel[35], théoricien du syndicalisme révolutionnaire aux influences marxistes, a écrit « La neutralité belge en théorie et en réalité »[36], un article publié en italien en 1921. Pour lui, la guerre est l’expression de la chute morale de l’Europe et son profond pessimisme l’a conduit au mutisme pendant toute la durée du conflit, par souci d’éviter d’être mal compris quant à son absence de soutien à l’Union Sacrée. Selon lui, le thème de la violation de la neutralité belge est un élément de propagande utilisé par les alliés tout au long de la guerre qui cache une double hypocrisie. D’une part, celle des puissances européennes pour qui la neutralité belge n’a jamais été voulue pour être respectée ; il le démontre en développant longuement ce que furent les ambitions annexionnistes de Napoléon III. Et d’autre part, celle des élites politiques et économiques belges qui ont volontairement négligé la préparation militaire de leur pays. Il rappelle que les deux rois Léopold n’ont pas obtenu du parlement le vote de crédits pour la défense préconisées par le Lieutenant-Général Brialmont, officier du Génie chargé de la construction des fortifications[37]. Il dénonce l’égoïsme de la bourgeoisie belge, tant libérale que catholique, qui considère le militarisme contraire à ses intérêts : cela entrainerait une augmentation des impôts et ce serait un mauvais signal envoyé aux partenaires économiques que de leur laisser croire que l’on se méfie d’eux : « La Belgique était devenue cependant si riche qu’elle pouvait, sans danger pour ses finances, supporter de lourdes dépenses militaires ; mais sa bourgeoisie avait toujours peur que, sous prétexte de défendre de nouveaux forts, on n’augmentât l’armée. (…) Lorsque des officiers, effrayés par l’expérience de la récente guerre franco-allemande, essayèrent d’agir sur l’opinion publique pour lui faire comprendre la nécessité d’une loi de recrutement qui fut en harmonie avec les besoins nouveaux, ils furent dénoncés en 1873 par divers parlementaires comme des séditieux[38]. » Sorel oppose à la Belgique le modèle suisse en citant Heinrich Zshokke : « Notre indépendance ne repose pas sur les documents signés par des ministres et les promesses des empereurs et des rois ; elle repose sur une base de fer, sur nos épées »[39].
D’une certaine manière, les idées de Sorel rejoignent celles du Cardinal Mercier quand il appelle ses concitoyens, ses frères, à l’examen de conscience : « (…) nous reconnaissons qu’Il nous châtie parce que nous avons péché (…). Il serait cruel d’appuyer sur nos torts, au moment où nous les payons si durement et avec tant de grandeur d’âme. Mais n’avouerons-nous pas que nous avons quelque chose à expier ? (…) le niveau moral et religieux du pays montait-il de pair avec sa prospérité économique ? (…) Nous travaillions, oui ; nous priions, oui encore ; mais c’est trop peu. Nous sommes, par devoir d’état, les expiateurs publics des péchés du monde. Or, qu’est-ce qui domine dans notre vie, le bien-être bourgeois ou l’expiation ?[40] »
En mai 1940, c’est encore au nom du respect de la neutralité que les troupes françaises n’entrent sur le territoire belge que le jour de l’invasion allemande. Cette fois encore, les armées belge et française n’empêchent pas l’ennemi de franchir la Meuse et d’envahir la France, « l’étrange défaite[41] » fait suite à la « drôle de guerre » …
La cloche de l’Actif II a été repêchée après la guerre par un scaphandrier embauché par André. Celui-ci tente de relancer une activité de cabotage sur la Manche qui amène la famille De Bruyn à s’installer successivement à Rouen et à Boulogne-sur-Mer. André étant de santé fragile, son médecin lui recommande la chaleur du midi, et c’est à Golfe-Juan que la famille s’établit, le temps d’épuiser le reste des rentes … Désargentés – « De Bruyn de La Rindinspoche[42] », comme le disait avec beaucoup d’humour mon arrière-grand-mère – c’est au « Moulin de l’étang » chez mes grands-parents, à Cambronne-lès-Ribécourt dans l’Oise, qu’André et Isabelle terminent leur vie, respectivement en 1959 et 1965.
[1] Blog de Jacques Brilot consacré à Godinne ; plusieurs entrées à propos de le famille du Ry-Motte-De Bruyn.
[2] Le château Motte à Frasnoy
[3] Tilly, Pierre. « Fleuves et canaux dans la zone franco-belge entre 1814 et 1914 : vers une redéfinition des espaces ? », Revue du Nord, vol. 416, no. 3, 2016, p. 597
[4] Tilly, Pierre, article cité p. 591
Lire plus particulièrement les propos de Paul Devaux, un des chefs du parti libéral belge.
[6] Tilly, Pierre, article cité, p. 582
[7] Lentacker, Firmin, La frontière franco-belge. Étude géographique des effets d’une frontière internationale sur le vie de relations, Service de reproduction des thèses, Université de Lille III, 1973, pp. 172-173.
[8] Notice sur Metternich dans l’Encyclopédie Universalis
[9] Handelsman, Marceli, article cité, p. 861
[10] Beyer, Antoine. « La Belgique à la croisée des chemins. Une géohistoire des grandes infrastructures de transport du Plat Pays à l’aune de ses frontières », Annales de géographie, vol. 681, no. 5, 2011, p. 469
[11] Othon, prince en Bavière, est élu roi de Grèce en 1832 lorsque la Grèce devient un État indépendant
[12] Handelsman, Marceli, article cité, p. 862
[13] Handelsman, Marceli, article cité, p. 866
[15] https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Camillo_Benso_comte_de_Cavour/112222
[16] Chevalier, Christophe. « Les réactions en Belgique au traité de Turin de 1860. Enjeux sécuritaires et effervescence patriotique », Relations internationales, vol. 166, no. 2, 2016, pp. 9-24.
[17] https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabarit_Freycinet
[18] Tilly, Pierre, article cité p. 592
[20] Coquelin, Charles. “LES CHEMINS DE FER ET LES CANAUX. De La Rivalité Actuelle Des Chemins de Fer et Des Voies Navigables En France, En Angleterre et En Belgique.” Revue Des Deux Mondes (1829-1971) 11, no. 2 (1845): 269–301
[21] Tilly, Pierre, article cité, p. 591
[22] Des extraits du journal du Général Pétain sont cités dans : Bourget, Pierre, Fantassins de 14, de Pétain au Poilu. Presses de la Cité, 1964.
[23] Porte, Rémy, 1914, Une année qui a fait basculer le Monde, Armand Colin, 2014, p. 168
[24] Steg, Jean-Michel, Le jour le plus meurtrier de l’histoire de France, 22 août 1914, Fayard, 2013, annexe 1 p. 252
[25] Bourget, Pierre, Op. cité, p. 102
[26] Bourget, Pierre, Op. cité, p. 82
[27] Steg, Jean-Michel, Op. cité, annexe 2 p. 248
[28] https://www.accueil-abbaye-maredret.info/about_us
[29] Texte de la lettre « Patriotisme et endurance » sur le site Gallica de la BNF
[30] Lettre pastorale p. 15 « À Rome, j’ai appris, coup sur coup, la destruction partielle de la collégiale de Louvain, l’incendie de la bibliothèque et d’installations scientifiques de notre grande Université, la dévastation de la ville, les fusillades, les tortures infligées à des femmes, à des enfants, à des hommes sans défense. Et tandis que je frémissais encore de ces horreurs, les agences télégraphiques nous annonçaient le bombardement de notre admirable église métropolitaine, de l’église Notre-Dame de la Dyle, du palais épiscopal, et de quartiers considérables de notre chère cité malinoise. »
[31] Lettre pastorale p. 21
[32] Le Psautier de Saint Louis, manuscrit de la 2ème moitié du XIIIe siècle, conservé à la BNF
[33] Vanwijnsberghe, Dominique, « Sœurs d’armes » La lettre pastorale du cardinal Mercier et les bénédictines de Maredret, Trema, Namur, 2018.
Cet album présente et commente le travail réalisé par l’atelier d’enluminure de Maredret et reproduit la totalité des planches en couleurs ainsi que de nombreux agrandissements de détails.
Les 35 planches sont visibles en ligne à cette adresse.
[34] Vanwijnsberghe, Dominique, Op. cité p. 17 : « Mais le manuscrit est particulièrement compromettant. Il doit être mis en sécurité jusqu’à la fin de la guerre, car l’ennemi guette. Le 23 juin 1916, Guillaume II en personne avait rendu visite à l’abbaye et rencontré l’abbesse (…). Il connaissait bien le travail des sœurs belges car la première tâche importante confiée à l’atelier de Maredret fut, en 1899, une Règle de Saint Benoît commandée pour le Kaiser par l’abbé de Maria Laach dans l’Eifel. »
[35] Notice sur Georges Sorel dans le dictionnaire biographique « Maitron »
[37] Sorel, article cité p. 200. Brialmont : « Trop de prospérité et de bonheur ont rendu les Belges ingrats avec la fortune et trop confiants dans l’avenir. Ils croient fermement qu’aucun danger ne peut menacer leur nationalité. »
[38] Sorel, article cité p. 201
[39] Sorel, article cité p. 200
[40] Lettre pastorale pp. 25-26
[41] Référence au témoignage de l’historien Marc Bloch, l’Étrange défaite, écrit en 1940 et publié en 1946 dans lequel il explique que selon lui, il n’y a pas eu de véritable volonté de s’opposer à la victoire de l’Allemagne d’Hitler.
[42] Traduit du wallon au français : « de la rien dans sa poche » …